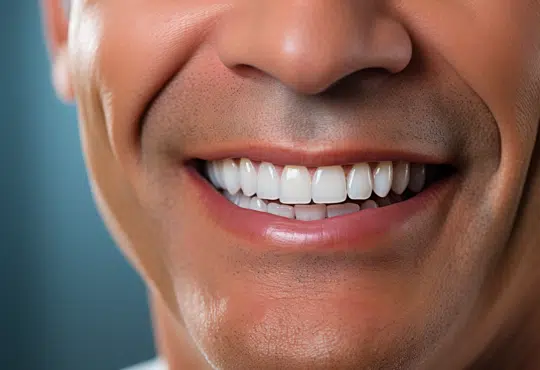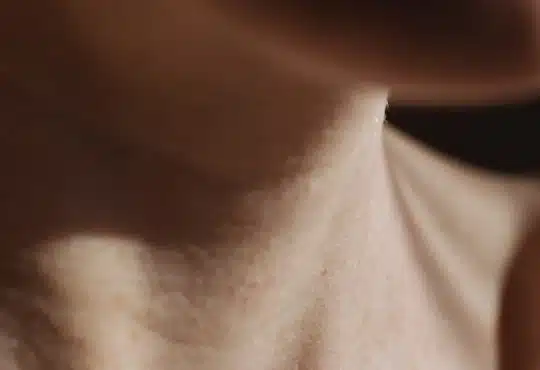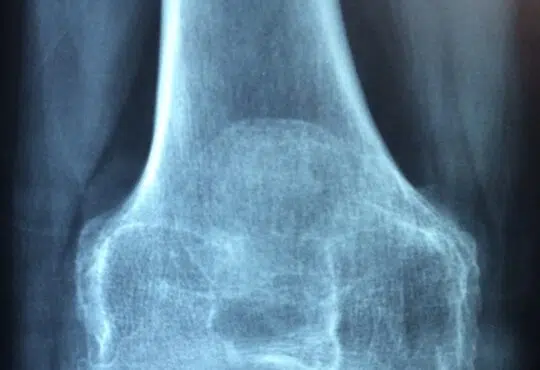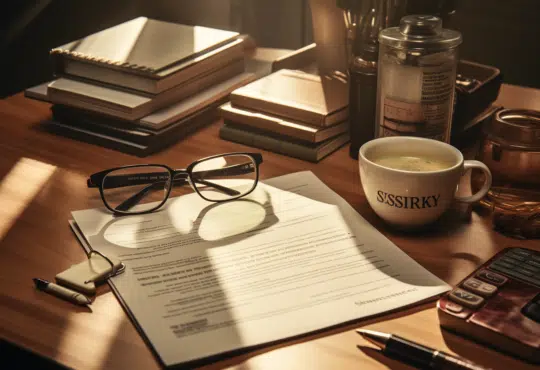Est-ce bien de manger du fromage le matin ?
Nous avons maintenant assez de recul pour savoir que les « régimes » doivent être bannis ! En effet, dans 90% des cas, il s'agit d'un échec à long terme dû à la nourriture et à l'hyper-contrôle mental. Au lieu de cela, il est fortement conseillé de se tourner vers un rééquilibrage alimentaire, à une alimentation plus saine et plus respectueuse de nos...