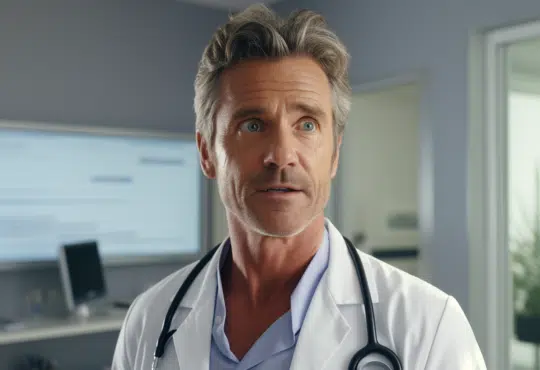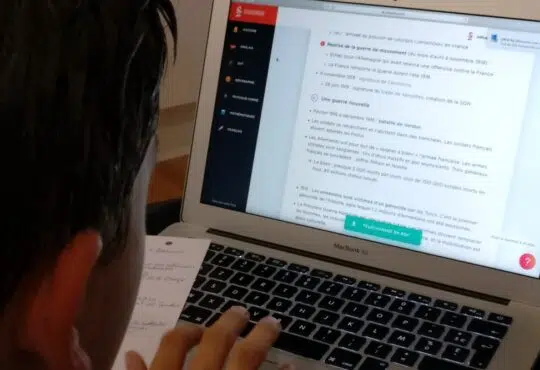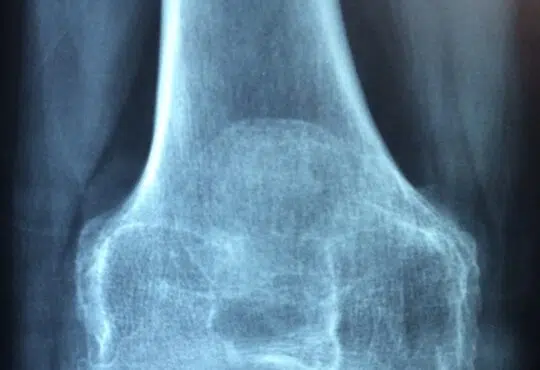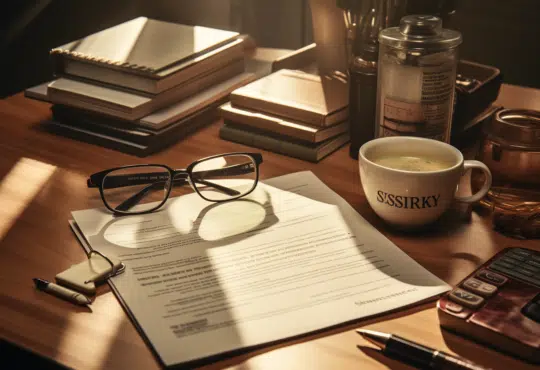Pain de singe : ses bienfaits et vertus sur la santé
Connu également sous le nom de « fruit du baobab », le pain de signe provient de l’Afrique, de la Nambie, du Mozambique et du Zimbabwe. Outre ces substances nutritionnelles remarquables, ce produit est parfait pour limiter les dénutrirons chez les personnes âgées. Très apprécié en France, ce puissant antioxydant renferme également d’autres atouts incontestables pour la santé. Découvrez les autres avantages...